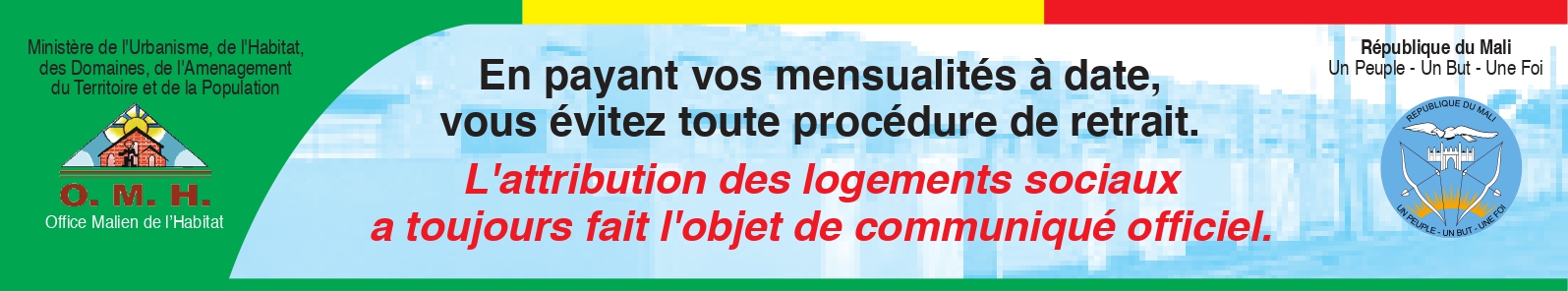C’était le thème d’une table ronde tenue ce samedi 19 juillet à Bamako. Un sujet à la fois “délicat et fondamentale“.
Elle était organisée par Youri Communication en partenariat avec Africable télévision. Dénommée Forum à la Une, elle est à sa troisième édition. Plusieurs experts dans des domaines différents ont intervenu sur diverses questions.
En effet, selon les organisateurs, ce forum a été réfléchi après que l’Union Africaine ait décrété 2025 comme l’année des réparations, avec comme thème officiel : “Justice pour les Africains et les personnes à d’ascendance africaine par le biais des réparations“. Une décision prise lors de la 37ème session ordinaire de l’assemblée de l’UA tenue en février 2024 à Addis-Abeba.
D’après les organisateurs, ces échanges avaient pour objectif de faire progresser le discours et les actions en faveur de la justice réparatrice pour les injustices historiques issues de l’esclavage transatlantique, du colonialisme , de l’apparteid, ainsi que du racisme systémique persistant. Toute chose qui, d’après eux, inclut non seulement des compensations financières, mais aussi des restitutions symboliques, entre autres.
<< Nous ne sommes plus à l’heure des silences complices, ni des amnésies opportunistes. L’histoire nous rappelle et nous interpelle que la justice même tardive est une exigence morale et un pilier de la réconciliation >>, a introduit Robert Dissa.
À l’en croire, cette table ronde est un appel à la réflexion, un espace de dialogue constructif. Surtout une plateforme pour aborder de front la question cruciale des réparations et des compensations.
Autour de la table des éminentes personnalités et experts ont éclairé à tour de rôle sur les questions liées entre autres : à des compensations justes et durables, aux échecs de la CPl et perspectives d’une cour Africaine, à des réparations pour un développement durable. Sans oublier les interrogations concernant l’évaluation des dommages et compensations financières, ainsi qu’à l’impératif des compensations et pistes d’action. C’était devant un parterre de journalistes.
En prononçant le discours d’ouverture, Pr. Alkadry Diarra, président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) dira qu’il s’agit bien d’un sujet aussi épineux que nécessaire dans notre société en quête de paix sociale, de réconciliation et de cohésion nationale.
D’abord c’est quoi le statut de victimes ?
En se basant sur la Résolution de l’assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2005, sur les principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours effectif et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, le président du CNDH, affirme qu’on entend par « victimes » les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire.
Daouda Nama Tékété, journaliste écrivain ouvre le débat en affirmant que “notre authenticité africaine a été tué en nous“. Sur le sujet du passé colonial au futur panafricain : les enjeux et les modalités des compensations juste et durable, le doyen Tékété, nous plonge dans l’histoire de la colonisation tout en alertant la jeunesse que l’occident continue de perpétrer des crimes contre les africains en mettant des battons dans “nos roues” sur les chantiers de développement et de souveraineté. Selon lui, ils ont d’abord réussi à détruire notre culture et notre éducation.
<< Quand on prend aujourd’hui les Africains, celui qui n’a pas le nom arabe, a les noms européens. Alors qu’il existe des noms que nos ancêtres nous ont donné. Ce travail ils l’ont fait depuis des siècles>>, a-t-il regretté.
Cependant, il a salué l’initiative de l’Union Africaine qui a dédié cette année à la réparation des crimes qui nous ont été causées.
Et selon lui, il faut d’abord se demander si nous même connaissons ces crimes. Pour répondre à cela, il dira que ses observations l’amènent à dire qu’aussi longtemps que les jeunes ne sont pas éveillés, induit de la connaissance de leurs histoires, qu’on arrivera jamais à la réparation de ces crimes.
<< Le plus grand défi des Africains aujourd’hui, c’est d’apprendre à se connaître, à s’aimer, à se respecter, à se connecter avec leurs ancêtres méritants, à réaliser ce que les autres n’ont pas été capables de faire. À savoir: s’affirmer et fabriquer leur patrimoine social >>, a-t-il déclaré.
Quand au deuxième intervenant, Assane Maguette Seye, consultant international, il a développé le thème : vers une justice réparatrice pour l’Afrique, limites de la CPI et perspectives d’une Cour Africaine. Il a rappelé la création de la Cour Pénale internationale (CPI) par le statut de Rome du 17 juillet 1998. Dont l’adhésion du Mali n’a pas été tardive, car d’après lui, il l’a rejoint le 16 août 2000.
La CPI, une Cour à deux vitesses ?
À en croire l’éminent juriste Seye, en analysant les actions de la CPI de sa création à ce jour, l’on se rend compte que sur une trentaine d’affaires véritablement engagée, 17 ont été traitées, 14 concernent les dirigeants africains. Est-ce à penser que l’Afrique commet plus de crimes que les autres continents ? Est-ce à penser qu’il s’agisse d’une justice à géométrie variable ? Ce qui est évident selon lui, par exemple, ce qui s’est passé en Irak en 2003 malgré le fait qu’on n’a toujours pas de preuve que ce pays possède “des armes de destruction massive“. Y compris ce qui s’est passé en Libye en 2011. << Alors on est tenté de dire que Oui cette justice est à deux vitesses >>, a-t-il répondu.
Vers la création d’une Cour Pénale Sahélienne
Cependant, il rejette le fait de se plaindre uniquement et il demande d’agir. Et à ses dires, c’est ce qui a amené le Mali, le Burkina Faso et le Niger, au delà de cette dynamique panafricane qui est l’Alliance des États du Sahel (AES), à avoir l’initiation de ce qu’on appelle la Cour Pénale du Sahel. Une très belle initiative qui a vocation d’avoir une cour pénale au niveau de cette sous région qui va juger les crimes.
<< Aujourd’hui c’est la Cour Pénale Sahélienne qui peut être qui doit être une initiative crédible >>, a-t-il dit.
Maintenant est-ce qu’il faut se contenter d’une juridiction sous-régionale ? Où est-ce qu’il faut qu’il ait un travail au niveau national et continental ?
Il répond qu’il faut envisager un processus à trois niveaux. Au niveau national avec les tribunaux, les structures indépendantes et Étatiques, au niveau sous-régional et ensuite une sorte d’instance suprême qui peut être là Cour Pénale Africaine.
Sur les réparations et compensations, il a fait comprendre qu’il est difficile de demander réparation et compensations lorsqu’on est dans l’approximation. Il faut aller à un projet à tiroir c’est-à-dire, ajoute t-il, par rapport à tel événement, par rapport à tel période voici les données que nous avons quantifié. Voici les réparations que nous exigeons. Même s’il reconnaît que les réparations ne sont pas uniquement d’ordre financière.
<< Prioritairement ce n’est pas eux qui vont par leurs réparations et compensations faire de nos pays, des pays riches. Il ne faut pas que nous comptions sur cela>>, a-t-il conseillé.
Youssouf Z Coulibaly, docteur en droit public, membre du Conseil National de la Transition (CNT), quant à lui, en édifiant sur l’impératif des compensations et réparations et pistes d’actions concrètes pour le Mali et l’Afrique, a évoqué les modalités et les formes de ces réparations, leurs mises en œuvre et les fondements juridiques, sur quoi nous nous basons pour demander réparations et compensations ?
Les formes et modalités proposées sont les réparations financières et les réparations non financières. Sur ce point, il a souligné qu’il est difficile de les quantifier, donc, il préconise de trouver des voies et moyens pour demander la réparation et de quelle manière ? Pour lui, il faut introduire la notion de compensation.
<< Vous savez en matière des actes posés par les États où les individus, on a coutume de dire que tout acte engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. Action où fonction ? Nous sommes face à l’action. Les actes ont été posés. Il faut réparer >>, a-t-il expliqué.
Pour identifier les victimes et les cas et procéder à la demande des réparations, il conseille de mettre en place un comité d’experts composé des historiens, des juristes, des économistes. Il demande aussi d’exiger la mise en place des fonds de compensations pour le financement du développement. De reconnaître la colonisation comme crime contre l’humanité. Sans oublier la restitution des œuvres d’art et des biens qui ont été “pillés“.
Fousseyni Ouattara, économiste, expert en finance du marché, vice président de la commission défense du CNT, pour sa part, dira que les coupables sont connus. Il a exposé sur la notion de quantification et d’évaluation des dommages coloniaux au mécanisme de réparation financière et de restitution.
<< La colonisation est un crime odieux. Les coupables sont connus. Les victimes sont connues. Ce qu’ils nous ont volé. C’est difficile de les quantifier. S’il faut faire une estimation de tout ce qu’ils nous ont pris, il faut aller voir seulement au niveau du trésor de la France, la quantité d’or qui est déposée là-bas. Je peux vous assurez que les 2/3 des 4800 tonnes d’ors viennent de l’Afrique. La même chose en Angleterre, plus de 2000 tonnes d’ors. Sans oublier pour l’Espagne, le Portugal et même là Hollonde >>, a-t-il laissé entendre.
En outre, il rejoint son prédécesseur pour ajouter qu’il faut un comité d’experts pour estimer d’abord tout ce qui a été confisqué.
<< Nos pays ont besoin aujourd’hui de l’or qui nous ont été enlevés>>, a-t-il insisté.
Mohamed Ousmane AG Mohamedoune, expert en communication et diplomatie, président de la commission du développement rural de l’environnement et de l’assainissement du CNT, en clôturant le tour de table, a communiqué sur les réparations coloniales, un impératif de justice pour le développement durable au Mali. Selon lui, il s’agit de dire la vérité non pour diviser, mais pour construire.
<< Pendant plusieurs siècles des millions d’hommes et d’enfants ont été arrachés à leurs terres, à leurs langues, à leurs humanités. Réduits en état de marchandises. Déshumanisés au nom du profit, justifiés au nom d’idéologie perverse>>, a-t-il rappelé.
À l’en croire, l’esclavage transatlantique et transoriental, et la colonisation ont laissé derrière, plus de société fracturée, des cultures humiliées, des mémoires blessées. Ces crimes ont longtemps été niés, relativisés sous les prétextes fallacieux que les victimes n’ont rien réclamées.
Par ailleurs, il demande d’allez plus loin, en intégrant la question de l’esclavage. Il estime également que ces crimes doivent être évalués, estimés et chiffrés pour compenser les dégâts. Pour lui, cela va permettre d’accroître le niveau de développement de nos pays.
<< Cette question de réparation ne doit pas être négligée. Parce qu’elle va être une valeur ajoutée à notre développement, à notre économie et même à notre moral>>, a-t-il fait savoir.
Moussa Sékou Diaby